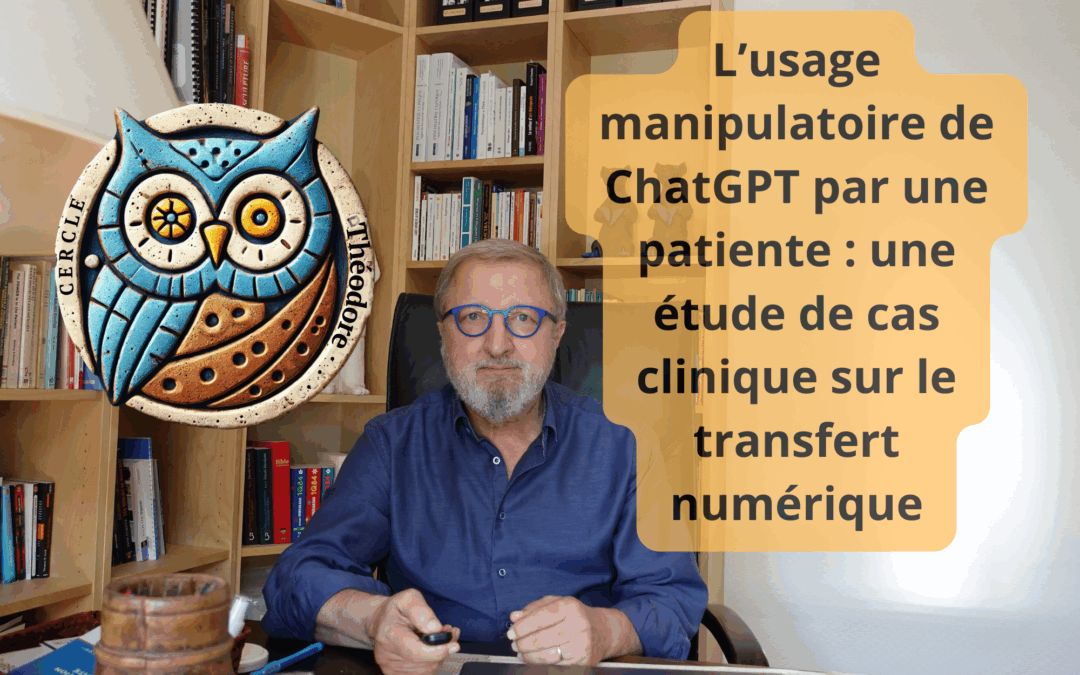Auteur : Dr Guy M. Deleu, Psychiatre
Introduction L’arrivée des agents conversationnels de type ChatGPT en soutien psychologique offre des possibilités nouvelles d’échange, mais expose également à des dérives encore peu explorées. Cet article propose une étude de cas illustrant comment une patiente souffrant de schémas dysfonctionnels a utilisé ChatGPT de façon manipulatoire pour réactiver ses dynamiques psychiques internes, notamment son transfert négatif.
Contexte clinique Madame C., 45 ans, en arrêt maladie pour épuisement professionnel, souffre de trouble dépressif majeur et d’anxiété chronique. Les schémas de Young révèlent une recherche d’approbation très élevée, une abnégation marquée, un sentiment d’échec et une tendance à la punition. Elle exprime une estime d’elle-même très basse, se décrit comme sans valeur et facilement influencée par l’avis d’autrui.
Usage de ChatGPT : le retournement de la bienveillance Ayant découvert ChatGPT comme outil d’échange thérapeutique, Madame C. se plaint très vite que « ChatGPT est trop gentil avec moi ». Sur TikTok, elle trouve un influenceur qui partage des prompts pour rendre le chatbot « plus direct, sans filtre ». Elle les utilise et obtient des réponses plus sèches, parfois critiques, qui selon elle « marchent mieux ». Elle dit être soulagée sur le moment de cette posture plus frontale, mais constate que cela ne l’apaise pas durablement.
Analyse psychodynamique Ce comportement révèle une relation transférentielle avec l’IA. La patiente projette sur ChatGPT une figure d’autorité jugée, dans son monde interne, plus légitime si elle est sévère. Elle rejette la bienveillance comme inadéquate, voire mensongère. La fonction du chatbot devient alors celle d’un Surmoi extériorisé, que la patiente alimente et orchestre. En cela, l’outil devient un miroir de ses propres schémas : punition, perfectionnisme, invalidation de soi.
Implications cliniques Cette situation interpelle le clinicien sur plusieurs plans :
- L’usage de l’IA n’est pas neutre : il peut devenir un vecteur de compulsion de répétition.
- Les schémas pathologiques peuvent être rejoués dans l’interaction avec le chatbot.
- Le refus de la bienveillance est un signal clinique fort, indiquant un rapport distordu à la compassion, souvent internalisée comme menace.
Conclusion L’intégration de ChatGPT dans le paysage psychothérapeutique invite à une vigilance éthique et clinique. Si l’outil peut soutenir la réflexion et offrir une présence textuelle contenant, il peut aussi, manipulé par le patient, devenir le théâtre d’un transfert numérique à forte charge projective. Il revient au clinicien d’aider le patient à prendre conscience de cette dynamique pour en faire un levier de transformation plutôt qu’un lieu de renforcement des croyances dysfonctionnelles.